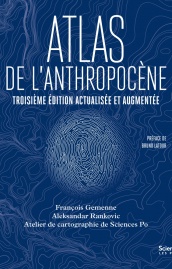Entretien avec François Gemenne
« Faire de la transition un projet de progrès »

Face au backlash actuel, François Gemenne revient sur les raisons d’un récit écologique remis en cause et avance des pistes pour répondre aux questions qui se posent avec force aujourd’hui : Comment fédérer autour de la question du développement durable ? Comment les acteurs économiques peuvent-ils agir en cette période d’incertitude ?
Atlas de l’Anthropocène, que vous avez coécrit avec Aleksandar Rankovic, est paru dans sa dernière édition en août dernier. Pourquoi cet ouvrage ?
Nous constatons aujourd'hui une très grande fragilisation du socle commun de compréhension des enjeux climatiques et environnementaux, avec la formation d’espaces de réalité très différents les uns des autres. L'idée même de cet Atlas est de fournir une appréciation commune du problème, en y rassemblant toutes les données nécessaires. La solution au problème dépend beaucoup de la représentation que nous en avons et donc de l’information dont nous disposons. C’est pourquoi cet Atlas était, me semble-t-il, nécessaire.
Paradoxalement, à l’heure où le constat scientifique est sans appel, les voix qui le réfutent sont toujours plus audibles…
Oui. Le constat de la réalité du changement climatique est devenu très largement partagé, et c’est précisément parce que ce discours porté par les scientifiques a été repris par les politiques, les industriels, les entreprises et par la société tout entière, qu’il est devenu l'objet d'attaques complotistes. Celles-ci s’intensifient et la grande difficulté est de ne pas sombrer dans une spirale du silence où une opinion qui est très largement majoritaire se sent minoritaire et donc se tait. Je pense qu'un enjeu important dans le débat public est de donner à entendre la voix de la majorité.
Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné ? L’écologie est devenue trop idéologique, trop polarisante ?
En effet, je crains que l’écologie soit devenue trop idéologique et trop polarisante, et je pense qu'on a un peu péché par naïveté en imaginant qu'il y allait avoir un rassemblement spontané sous la bannière de l'écologie, alors qu’elle recouvre des sujets qui ont tendance à diviser. On a sous-estimé les clivages que cela engendrait notamment sur les questions de redistribution sociale. Ainsi, le discours écologiste a souvent été perçu comme un propos donneur de leçons ou culpabilisateur, tenu par des gens relativement nantis qui n'étaient pas confrontés aux mêmes problématiques ni aux mêmes tensions que Monsieur et Madame tout le monde. Il y a aussi le sujet dénoncé par certains des figures de militants mises en avant : souvent des jeunes gens relativement aisés et dotés d’une certaine forme de capital social et culturel pour s'investir dans ces questions, et portant un discours parfois perçu comme déconnecté du vécu des gens ordinaires.
« Je crains que l'écologie soit devenue trop idéologique et trop polarisante. »
À l’automne dernier, des activistes espagnols militant pour le véganisme ont versé de la peinture sur un tableau représentant Christophe Colomb en protestant contre le néo-colonialisme, ce sont typiquement ces méthodes et cette addition des combats que vous dénoncez ?
Le but revendiqué de ces actions choc est de diviser l'opinion. Or, ce qui a fait le succès des manifestations pour le climat organisées par Greta Thunberg, c'est précisément qu'elle rassemblait des gens d'âge, de classes sociales et de sensibilités politiques différents. Les actions chocs, elles, cherchent à organiser des camps et à faire de l'écologie un marqueur idéologique. Ce faisant, elles renforcent d'une certaine manière leur propre camp, mais éloignent beaucoup de gens qui idéologiquement ne vont pas se retrouver dans les combats ici associés à l'écologie : contre le néocolonialisme, contre le capitalisme, pour la lutte des classes, ... Elles se coupent d'une partie de l'opinion et entraînent donc un phénomène de rejet d’ordre politique et sociologique qui atteint non seulement les politiques climatiques, mais parfois la science du climat elle-même.
Alors, comment rassembler ? C'est la grande question.
Je vois 2 manières qui sont complémentaires.
Premièrement, pour beaucoup aujourd'hui, la transition est au mieux synonyme d’une contrainte, au pire d’une régression. Il faut parvenir à faire de la transition un récit et un projet de progrès. Pas seulement, de progrès technologique, mais aussi politique, social, ou encore en matière de droits humains. C'est vital pour nos démocraties, parce que si nous ne parvenons pas à nous projeter positivement dans le futur, le risque est de vouloir se réfugier dans le passé, comme on le constate aux États-Unis actuellement.
Deuxièmement, il faut incarner ce projet car le récit ne suffit pas. Il faut qu'il se manifeste concrètement dans le quotidien des individus, en matière de transport, d’habitat, d'alimentation, ou encore de loisirs. Les gens doivent pouvoir voir que la transition est dans leur intérêt, qu'elle leur apporte des bénéfices et pas seulement des coûts, des contraintes ou des renoncements. Cela me paraît vraiment fondamental.
Quelles sont les nations qui regardent vers l’avenir ?
Contrairement aux États-Unis nostalgiques d’un passé largement fantasmé, la Chine se projette beaucoup vers le futur, dans ce qu'il a à la fois de meilleur, à savoir la transition énergétique, et dans ce qu'il a de pire, notamment sur la question du contrôle social. Il s’agit pour ce pays, non pas de l’expression d’une conscience écologique, mais clairement d’un projet de modernisation de son économie. C'est aussi une ambition de puissance géopolitique sur la scène mondiale, puisque la Chine a bien compris que le 21e siècle serait électrique et qu’elle a évidemment l'intention d'être une super puissance électrique.
« La Chine a bien compris que le 21ème siècle serait électrique. Elle a l'intention d'être une super puissance électrique. »
Parlons des entreprises. Dans un environnement de plus en plus incertain, comment observez-vous leur attitude en matière de développement durable ?
Toutes les entreprises ne se valent pas sur ce sujet. Certaines ont bien compris que leur transformation vers la durabilité était une condition de leur rentabilité future et ont engagé des transformations assez significatives, y compris parfois de leur modèle d'affaires. D'autres adoptent une logique attentiste, comme si le changement climatique était une crise passagère. Elles prennent donc le risque de rester complètement à quai dans l'économie du 21e siècle. Et puis, à l'heure où nous parlons, il y a beaucoup d'entreprises qui se posent des questions. Elles ne voient pas clair sur le plan réglementaire ou fiscal et hésitent à engager des transformations. L'enjeu, je crois, est d'essayer d'engager ces entreprises, en leur disant de ne pas tout attendre de mesures politiques et qu’elles peuvent aussi être à la manœuvre dans la continuité qu'elles réclament.
Luxembourg est une place financière importante. Vous avez dédié une nouvelle section à ce secteur dans votre ouvrage. Quel est votre message ?
La finance reste aujourd'hui l'énorme point aveugle de la transition. Énormément d'investissements restent consacrés à des projets contre la transition : extraction fossile, déforestation... Il est essentiel de réorienter ces flux. À l'heure où nous manquons d'argent pour le développement durable, nous comptons à mon sens beaucoup trop sur les pouvoirs publics. Une partie de l’épargne pourrait être très utilement réorientée pour financer des projets locaux de transition. Ce serait à la fois absolument nécessaire pour le climat et dans l'intérêt des épargnants.
Il existe bien entendu des initiatives positives mais l'enjeu est de les faire accélérer. Les grandes questions qui se posent pour les financiers sont : Comment déployer à plus grande échelle toute une série de véhicules d'investissements durables qui parfois existent mais de manière limitée ? Quels instruments macroéconomiques développer pour maximiser la rentabilité de ces investissements ? Comment faciliter la transparence de l'épargne car beaucoup d'épargnants n'ont aucune idée de ce que finance l'argent ? Le secteur de la finance n'a pas été suffisamment considéré et c'est en réalité un levier d'action extraordinairement puissant et une clé de la réussite de la transition.

Au Luxembourg Sustainability Forum 2025, interview de François Gemenne par Marie Sauvignon, IMS Luxembourg.
Vous êtes professeur au sein d'écoles de management comme HEC, comment définiriez-vous le leadership en matière de développement durable ?
Le leadership, c'est prendre le risque de développer de nouveaux modèles d'affaires. Ceci vient par définition se heurter à la force de l'habitude, l’inclinaison naturelle à poursuivre les chemins déjà tracés qui sont ceux auxquels la plupart des dirigeants ont été formés durant leurs études. Un enjeu central réside donc également dans la formation, notamment au sein des écoles de management. Le leadership en matière de développement durable consiste à tuer le « business as usual » pour que puisse émerger de nouveaux modèles économiques.

François Gemenne
Expert en géopolitique de l’environnement, co-auteur principal du 6ème rapport du GIEC, chercheur du Fonds National de la Recherche Scientifique à l’Université de Liège, François Gemenne enseigne également à Sciences Po, HEC Paris et à l’Université libre de Bruxelles. Il préside le Sustainable Finance Observatory, l’ONG Climate Voices, et le conseil scientifique de la Fondation pour la Nature et l’Homme.
À lire aussi dans le dossier « Face au backlash, tenir le cap durable »
- Accélérer les efforts malgré les vents contraires
- Une nouvelle Renaissance - Rencontre avec Mathieu Baudin
- 10 modèles durables qui font leurs preuves
- « Nous ne devrions pas sous-estimer ce que nous sommes capables de changer » - Entretien avec Clover Hogan
- Hugo Paul : Dans les pas d'un explorateur de communauté
- Une voie insoupçonnée : adopter l'esprit du jazz pour guider la transformation durable - Avec Alex Steele